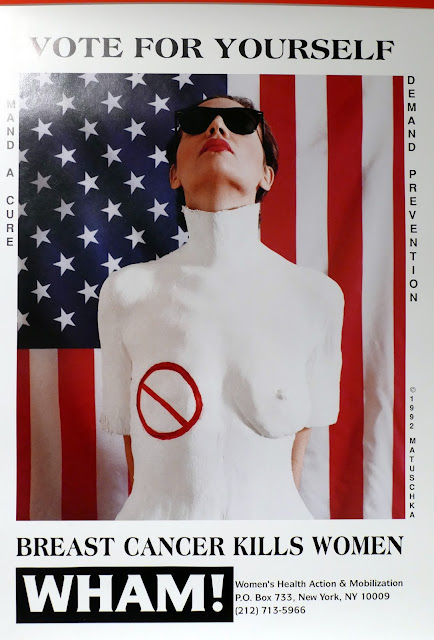En 1933, la presse commémora le cinquantième anniversaire de la mort de Richard Wagner. Un article en page 3 du Temps du 13 août rappelle l'amitié que Wagner porta toute sa vie aux animaux.
RICHARD WAGNER, AMI DES BÊTES
Est-il permis, en cette année de commémoration et d'apothéose, d'appeler l'attention sur un des côtés les moins connus peut-être du grand public, et qui n'est pas à la vérité un des plus importants de la personnalise de ce puissant génie?
Richard Wagner, en dépit de l'impérieuse dureté que lui prêtent ses portraits de Jaeger et de Lenbach, avait une sensibilité et une bonté indéniables. Il était notamment un véritable ami des bêtes, et il l'est resté à ses heures les plus critiques d'extrême détresse, aussi bien qu'à celles de sa plus somptueuse prospérité.
On sait qu'il aimait les oiseaux, et que c'est en écoutant leurs chants qu'il avait noté et composé pour Siegfried les Murmures de la forêt. Il aimait les cygnes dont il admirait l'élégante silhouette sur l'eau des étangs, les paons pour leur riche plumage, et il s'était pris d'amitié pour un perroquet dont Minna PlaNNer, sa première femme, lui avait fait don. Dans une page amusante, il a décrit les faits et gestes de ce perroquet "Papo". Papo l'appelait par son nom, Richard, lorsqu'il s'absentait trop longtemps. S'il ne lui répondait pas, il arrivait, en voletant dans son cabinet, et, posé sur sa table, se mettait a jouer d'une manière inquiétante avec la plume et le papier. Quand il percevait ses pas dans l'escalier, Papo l'accueillait par la marche finale de la Symphonie en ut mineur ou par le commencement de la 8ème symphonie en fa majeur, ou encore par un des joyeux motifs de l'ouverture de Rienzi.
Mais, dans l'ordre des animaux domestiques, la franche affection de Wagner se portait de préférence vers l'espèce canine. C'est ainsi, qu'il a gardé à ses côtés des chiens de différentes races. Il en a, dans ses Mémoires ou dans ses Lettres, laissé les noms, et il s'est plu à en écrire l'histoire, non sans une tendre émotion.
L'un des premiers qu'il eut, vers 1838, était un grand terre-neuve du nom de "Robber", qui lui donna beaucoup de soucis. Voyageant en voiture dans la Courlande, raconte-t-il, avec Minna, n'ayant pu l'y placer, ce fut une torture pour lui de voir ce pauvre chien à la lourde fourrure trotter toute la journée par une chaleur torride. Il ne put supporter ce spectacle atroce: il enfonça, de force, la bête épuisée dans la .berline pleine.
Après un voyage sur mer et une visite mouvementée à Londres, Wagner et Minna arrivèrent de Boulogne à Paris, en diligence, avec leur chien sur l'impériale. Ils s'installèrent, dit Wagner, au numéro 33 de la rue de la Tonnellerie, dans un petit hôtel sur la façade duquel était l'inscription "Maison où naquit Molière". Il ajoute: Robber était certainement un animal de valeur qui excitait l'admiration. Il faisait, dans le jardin du Palais-Royal, le bonheur des enfants par son habileté à rapporter ce qu'on lui jetait dans l'eau du bassin. Alors Wagner et Minna étaient dans les difficultés: ils venaient d'engager au Mont-de-Piété leur argenterie et leurs derniers bijoux. Un événement vint les frapper, comme un présage de malheur. Leur bon Robber disparut, probablement volé. Ceux qui connaissaient leur situation considérèrent cette perte comme un bienfait. On s'étonnait que, manquant même du nécessaire, ils se fussent chargés d'un chien da cette taille. Wagner était rempli d'amertume. C'est au milieu de ces tribulations qu'il travaillait aux 2ème et 3ème actes de Rienzi.
Puis, un an après, dit-il encore dans ses Mémoires, sortant de chez lui pour aller rendre un métronome qu'un ami lui avait prêté, il aperçut, au milieu d'un intense brouillard, le chien qu'on lui avait volé, et il appela Robber d'une voix stridente. L'animal le reconnut, mais, comme il marchait brusquement sur lui, celui-ci recula effrayé. Il le poursuivit, il se sauva plus rapidement. Et il courut en vain comme un fou jusque devant l'église Saint-Roch, où il s'arrêta en nage, haletant et portant toujours son métronome sous le bras, mais sans avoir pu rentrer en possession de son Robber.
Revenus en AlIemagne.Wagner et Minna s'étaient procuré un autre chien du nom de "Peps", qui vécut avec eux les jours d'émeute de Dresde. Ils l'aimaient beaucoup et, en Suisse, où ils avaient dû fuir, devant aller sur les montagnes des Quatre-Cantons pour soigner leur santé délabrée, ils ajournèrent leur saison, à cause de sa maladie. Résistant à tous les remèdes, soudainement atteint de convulsions, malgré les secours d'un médecin que Wagner ayant, la nuit, traversé le lac, était allé consulter, Peps mourut. "Ce moment produisit un effet si solennel , écrit Wagner, que je regardai ma montre, c'est à une heure dix minutes du matin, le 10 juillet 1855, que trépassa mon petit compagnon dévoué. Nous l'enterrâmes le lendemain sur le coussin de sa corbeille en pleurant amèrement. "
Dans une lettre à Mathilde Wesendonck, du 17 novembre 1860, Wagner lui disait: "Votre petit chien est tout fait délicieux. Croyez-moi, vous devez à cet animal beaucoup de joie la compagnie des animaux a quelque chose de très calmant."
Peps avait été remplacé par Fips, que lui avait envoyé Mathilde Wesendonck, et qu'il emmenait en promenade au bois de Boulogne. II lui annonça de Paris, rue de Lille, de la légation de Prusse, où le ministre de Pourtalès lui avait donné asile, que Fips était mort après cinq heures d'agonie, pendant lesquelles, dit-il, il restait toujours charmant, amical, sans pousser une plainte. Je l'enterrai, moi-même, à la dérobée, rue de la Tour-dès-Dames, dans la broussaille. Avec ce petit chien, j'ai enterré beaucoup de choses. Je veux voyager et je n'aurai plus de compagnon. (22 juin 1861). La mort de Fips eut des conséquences graves. Les animaux domestiques avaient toujours eu une très réelle importance dans le ménage de Wagner et de Minna, sans enfant. La mort de leur joyeux et aimable Fips sembla porter le dernier coup à une vie devenue impossible depuis longtemps. Mais, malgré ses intentions, Wagner ne devait pas laisser Fips sans successeur. Des voleurs lui ayant dérobé une montre en or, souvenir de l'orchestre de Moscou, un vieux baron, son voisin, lui donna un chien de chasse. "Il s'appelle "Pohl", écrit-il de Penzing-tes-Vienne, à Mathilde Wesendonck, il est brun et fort, mais déjà âgé. Bientôt, il mourra comme Fips et Peps, c'est une misère." PohI vécut, cepedant, toute la période de Munich; il mourut en 1866 sur les bords du lac de Genève. Il fut remplacé par "Russ", un; grand dogue danois, que la servante suisse Vraneli avait, elle-même, acheté a Genève, et qui,durant dix ans, fut doublement choyé.
Aux obsèques royales de Wagner, qui eurent lieu à Bayreuth, Cosima, désespérée et réfugiée dans sa douleur, ne parut pas, ainsi que le rappelle dans son beau livre M. Guy de Pourtalès. Mais, sur les portes de Wahnfried, devant le cercueil, on vit, tandis que la neige tombait, les enfants tenant en laisse les deux chiens de leur père, du Maître, du prodigieux génie, dont ces petits animaux avaient reçu les caresses et dont ils avaient été les compagnons fidèles.
A. Autrand